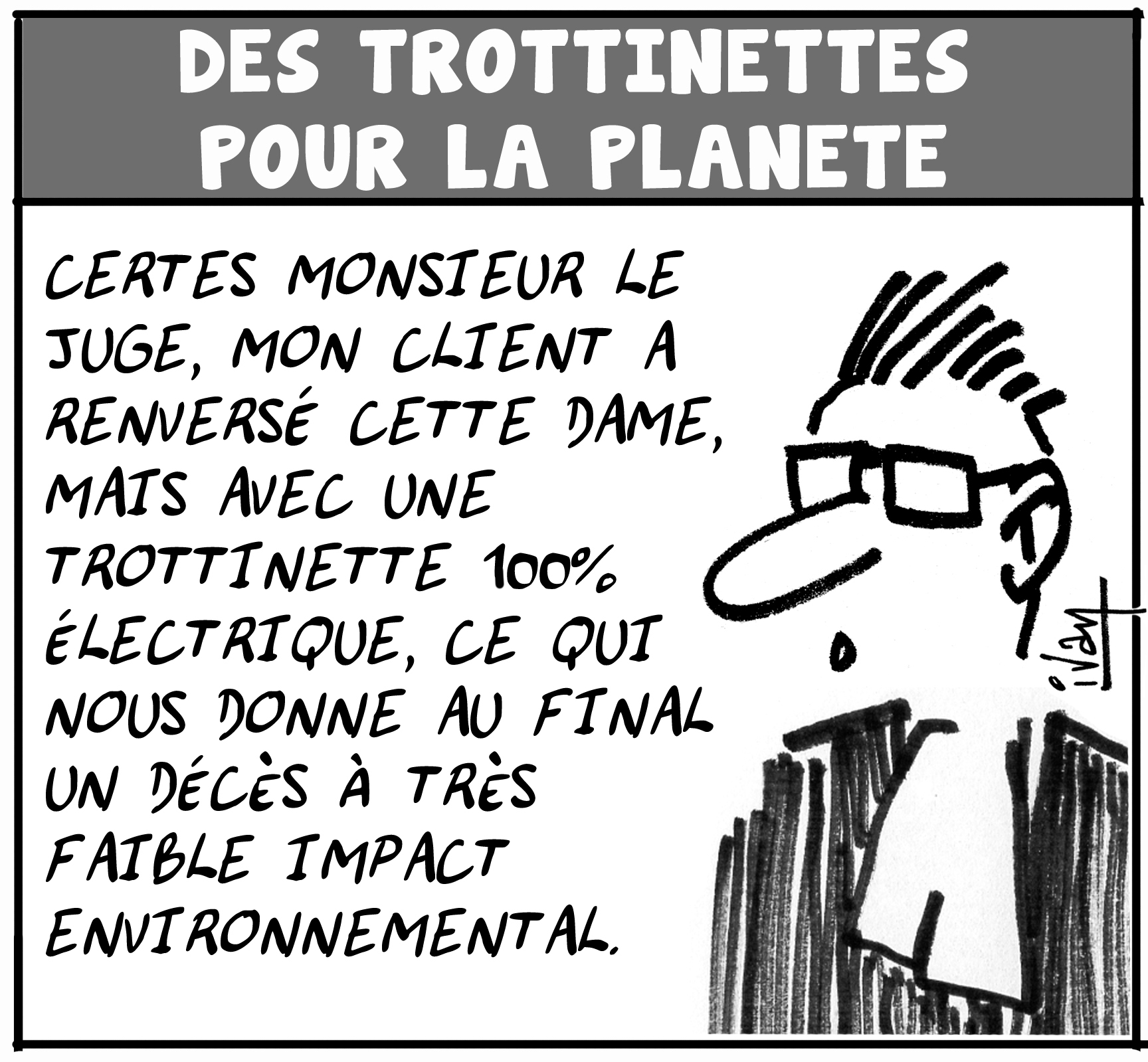Les franciliennes osent. Elles osent rouler à toute berzingue au milieu de la piste cyclable. Peut-être même lâcher une main, ou deux, lorsqu’elles sentent que c’est jouable. Mais ce n’est pas tout. Celles qui conduisent le bolide veulent maintenant en ouvrir le capot. Depuis plusieurs années déjà, les femmes investissent les ateliers d’autoréparation collaboratifs, pour apprendre à réparer par elles-mêmes. Une démarche militante qui passe par l’organisation d’ateliers réservés aux femmes. Et par l’aménagement de ceux partagés avec les hommes. De quoi faire couler beaucoup d’encre. En juin 2021, Aurélien Veron, élu au Conseil de Paris, épinglait la mairie sur son compte Twitter, l’accusant d’abord de financer et promouvoir « la ségrégation à Paris », puis « les invitations à la discrimination ». En cause : le référencement d’ateliers exclusivement féminins sur le site internet de la ville. On a donc voulu aller voir de plus près ce qu’il en est…