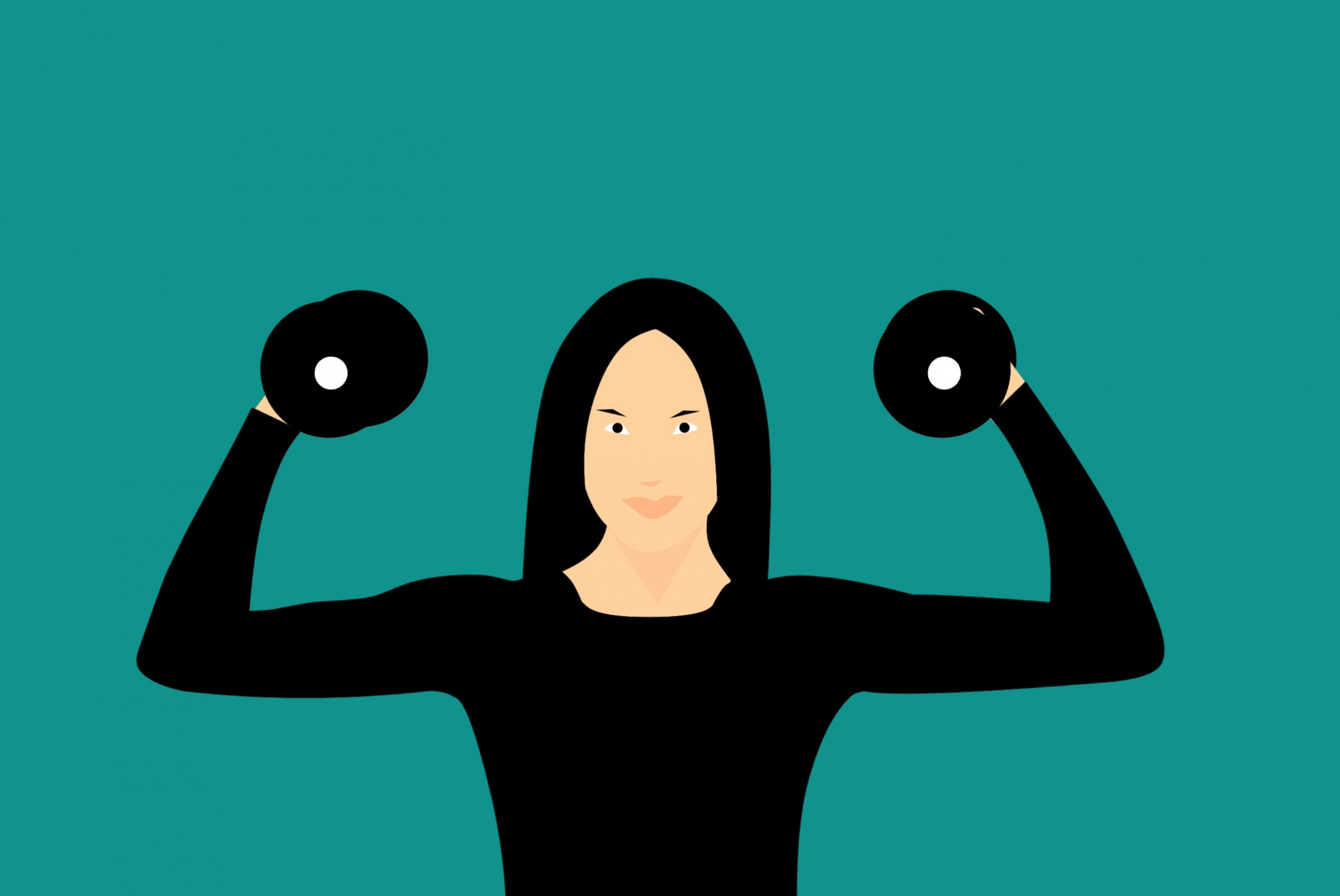La culture physique, un business en pleine forme ? [N°7]
« Faire du sport », cette résolution arrive en tête des engagements de 34% des Franciliens1. Pour tenir le cap, et se forger un physique valorisable sur le marché social, certains d’entre eux décident de s’inscrire dans une fabrique de leur corps. Ils ont l’embarras du choix : près de 1 000 salles de sport sont désormais recensées dans la région. Une prolifération qui a surpris vos chiffonniers. Allons donc nous muscler les mirettes.