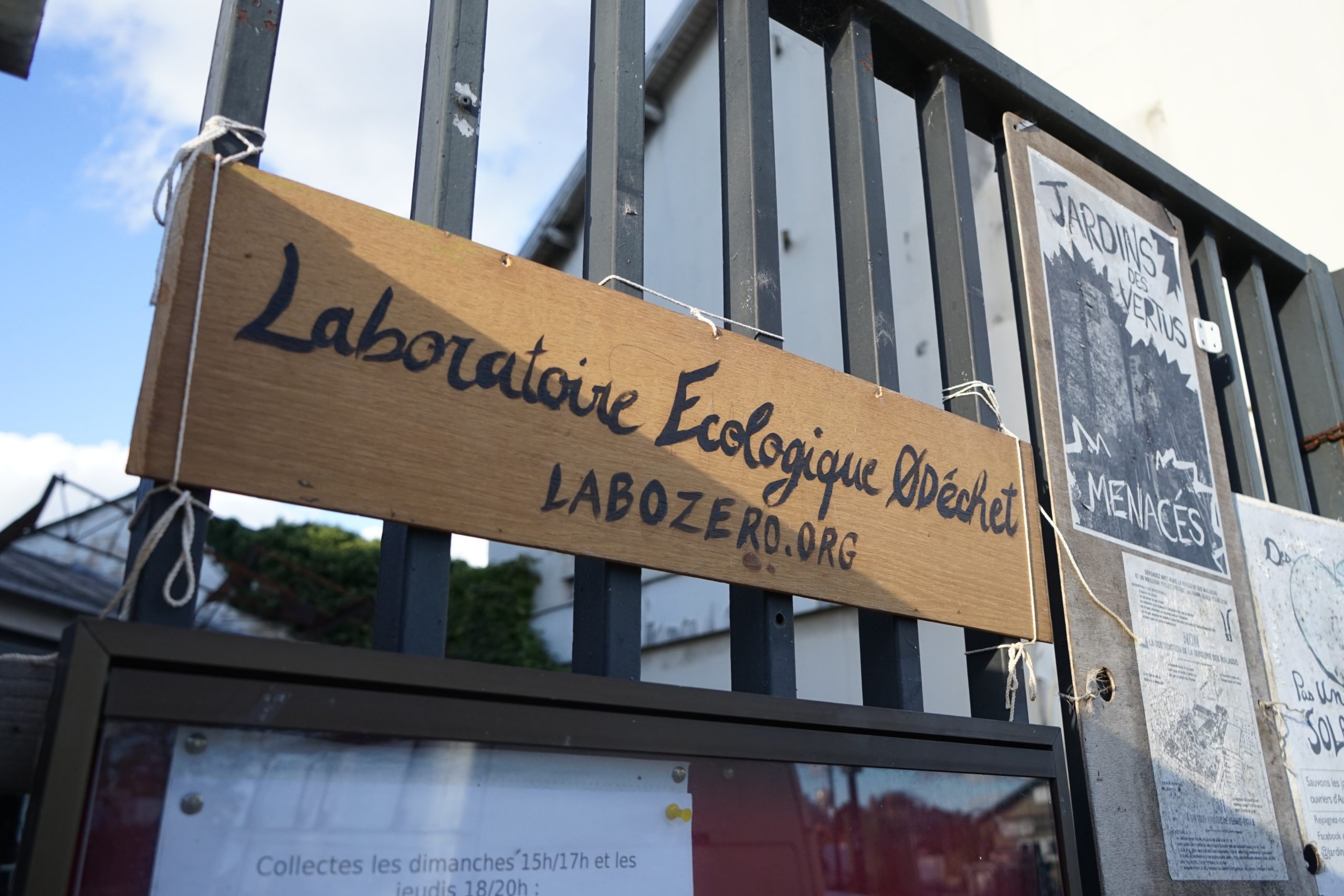Qui va cracker aux Quatre-chemins ? L’impasse des mobilisations habitantes [N°4]
Bientôt 30 ans que dans le Nord-Est parisien, l’on déplace, évacue et disperse, pour à nouveau rassembler et reléguer les personnes les plus dépendantes au crack. Il ne s’agit jamais de répondre aux besoins de ces individus marginalisés mais d’apaiser les mécontentements des riverains. Aux Quatre-Chemins, un mur a même été construit pour prévenir la contestation des habitants de ce quartier populaire. Ce dispositif autoritaire fonctionne-t-il ? Enquête sur le terrain.