Entretien avec Jean-Marie Brohm : « Presque plus personne ne critique l’idéologie et la pratique sportive » [N°11]
[Entretien publié en page 6 et 7 du Chiffon n°11 consacré aux JO de Paris 2024]![]()

![]()
Le Chiffon – Quand le sport apparaît-il ? Est-il consubstantiel à l’activité physique humaine ?
Jean-Marie Brohm – Il y a deux réponses possibles. La première provient de l’idéologie sportive traditionnelle. Des auteurs très sérieux expliquent que depuis des temps immémoriaux l’homme est un sportif qui pratique la natation, la course, la lutte, la boxe, etc.
La seconde réponse cherche à distinguer plusieurs choses. D’une part, elle rappelle qu’il y a des « activités corporelles » constitutives de l’humain depuis son hominisation. C’est ce que le grand anthropologue Marcel Mauss va appeler les « techniques du corps ». C’est le fait de savoir marcher, sauter, courir, nager, faire l’amour, accoucher, etc. Ces techniques du corps sont en partie variables d’une culture à l’autre et peuvent être considérées comme des activités physiques.
D’autre part, il y a le « sport » proprement dit, c’est-à-dire l’institution de la compétition physique codifiée. On le voit apparaître dans l’Antiquité. Mais il y a une césure très nette entre le sport dit « antique » (Grec) qui était un acte cultuel et le sport dit « moderne ».
Globalement, le sport moderne commence à se forger vers 1750 en Angleterre, c’est-à-dire là où le capitalisme s’ébauche . Les premiers sports institués avec des fédérations, des règlements, des records, vont être le rugby, le football, l’athlétisme, l’équitation et le tennis.
Le sport s’organise autour de trois caractéristiques majeurs. Primo, la compétition systématique comme finalité. Secundo, l’entraînement régulier comme préparation à la compétition. Tertio, l’insertion dans une structure institutionnelle organisant et contrôlant l’activité sportive (fédérations, clubs, comités, etc.) selon des règles strictes (classes d’âge et de poids, licences, conditions d’accès aux épreuves, etc.). Mais les frontières entre activités physiques et pratiques sportives peuvent être perméables. En outre, il y a une tendance à la professionnalisation (via le salariat) des sportifs, c’est-à-dire leur transformation en capital. C’est ce qu’entament les premiers clubs anglais de football qui vont ensuite s’exporter en France, notamment au Havre.
En somme, je distinguerais les « techniques du corps » spécialisées de l’être humain – que l’éducation physique contemporaine permet de stimuler – et le sport proprement dit qui est éminemment lié au capitalisme.
Pouvez-vous revenir sur les fondamentaux de la critique du sport ?
Rentrons un peu plus dans le détail. Le sport s’est avant tout organisé autour de la compétition qui est chronométrage (dimension temporelle) et mesure au millimètre près (dimension spatiale). Il faut la distinguer de l’agôn grecque qui était une confrontation dans l’effort physique sans découpage mesuré des performances.
Le sport moderne commence en Angleterre avec la chronométrie. Soit dit en passant, c’est pour cela que nous avions pour épigraphe de la revue Chrono enrayé « Les chronomètres n’ont fait jusqu’ici que mesurer les efforts aliénés de l’humanité, il s’agit à présent de les briser ». Cette compétition implique la lutte contre soi (dépassement de soi), contre les concurrents (dépassement des limites, quête de l’exploit suprême) et contre la nature (maîtrise des éléments et des situations).
Chez les Grecs, ce cadre compétitif n’était pas clairement défini. Même s’il faut noter que l’on a très peu d’information sur le déroulé des Jeux olympiques antique qui sont supposés avoir commencé au VIIe siècle avec J.C. dans la ville d’Olympie. Au début du XXe siècle, Pierre de Coubertin a profité de ce flou pour le combler par son imagination, forgeant l’idéologie olympique. Mais il a créé une vision imaginaire et fantasmée d’Olympie et des Grecs1.
Puis, il y a la professionnalisation. Dans les années 1920, il y avait des débats pour savoir si un sportif amateur pouvait être un vrai sportif. Les réponses apportées par les Étasuniens, les Anglais, les Allemands ou les Français ont tendu à dire que non. Lorsque Juan Antonio Samaranch, ex-franquiste, prend les rênes du Comité international olympique en 1980, il dit en gros « l’amateurisme c’est terminé », alors les sportifs vont de plus en plus être des salariés rémunérés pour faire carrière. Ça, c’est la structure globale du sport.
Ensuite, il y a ce que j’ai appelé la « sportivisation » de la société. C’est-à-dire que toutes les activités physiques aujourd’hui sans exception ont tendance à être transformées en sport. Par exemple les balades à vélo, la course à pied, le badminton, le ping-pong, etc. tendent à passer sous la coupe de la compétition. De plus en plus souvent, lors d’un jeu il faut savoir qui est le meilleur.
Le sport a en définitive pour caractéristique de cliver à l’infini le corps social : pratiquants et non pratiquants, hommes et femmes, jeunes et vieux, valides et invalides, vainqueurs et perdants, dopés et non dopés, professionnels et amateurs, masse et élite, experts et débutants, etc.
Je tiens à ajouter qu’en plus de cela, le sport a trois piliers idéologiques. À savoir : « Quel est le meilleur sportif de tous les temps ? », et ce pour chaque discipline. C’est ce sur quoi spécule très bien le journal L’Équipe par exemple. Ensuite : « Jusqu’où pourront aller les records ? » (« Plus vite – Plus haut – Plus fort », comme le dit bien devise olympique). Enfin : « Le potentiel du corps humain est-il illimité ? ».
C’est sur ce dernier point que se greffe entre autre la pratique du dopage qui cherche à augmenter les potentialités biologiques, psychologiques, alimentaires, cardiaques, respiratoires de l’être humain. Aujourd’hui, le dopage se prolonge dans les discours sur le « post-humain » qui s’appuient sur la recherche scientifique et technologique pour poursuivre avec de nouveaux moyens (prothèses, biotechnologies, etc.) l’« amélioration » des performances physiques.
La Théorie critique du sport a pour but de rappeler que le sport, c’est avant tout cela. Et il faut notamment le faire comprendre aux professeurs d’éducation physique et sportive (EPS). J’ai essayé d’expliquer à mes collègues à l’École émancipée2 que l’éducation physique ce n’est pas le sport. Que le sport n’est pas un moyen privilégié d’éducation physique puisque précisément, il consiste à éviter la solidarité, à augmenter la violence de la compétition et le narcissisme égotique.
L’une des objections que l’on pourrait vous faire consisterait à dire que le sport n’est pas le problème en prenant l’exemple de la danse ou des échecs qui sont eux aussi soumis à la compétition et à la professionnalisation de la pratique. Cela est-il pour autant néfaste ? Peut-on dire que la danse et les échecs sont des sports ?
Là, il faut revenir à des questions fondamentales. Que produit un sportif ? Pas grand-chose, à part de la sueur et du spectacle. Alors, vous me direz que les danseurs ou les joueurs d’échec produisent aussi sueur et spectacle. Mais la différence essentielle, c’est que les danseurs sont au service d’une œuvre. Si l’on prend un danseur du Sacre du Printemps mis en scène par Maurice Béjart, par exemple, il participe à une œuvre immortelle.
En contre-point, que produit du point de vue esthétique et culturelle le sportif ? Presque rien. Ce dernier tend à être oublié rapidement après son apogée, englouti dans le renouvellement incessant des champions.
À ce moment-là, il faudrait distinguer sport et culture. Quels seraient les critères pour séparer l’un de l’autre ?
Le sport n’est pas une culture. C’est comme si l’on disait que la guerre, c’est une culture. Nous pourrions aussi dire cela après tout ! Qu’il y a une « culture guerrière », une « culture militaire ». Mais si tout est culture, plus rien n’est culture.
Nombreux sont les philosophes, notamment Platon, à avoir fait la distinction entre ce qui élève l’intelligence (la noblesse d’âme, nous pourrions dire) et la culture de masse. Je dis qu’une culture de masse est rarement une culture. C’est un pléonasme. À contrario, le sport est aujourd’hui un élément de contrôle social massif.
Herbert Marcuse écrit dans Éros et Civilisation que l’ « Éros » ce n’est pas seulement faire l’amour, mais que cela a à voir avec la culture comme force de pacification générale des sociétés. Il y a certes un côté utopique là-dedans. Nous sommes en tout cas bien loin de l’affrontement institué par la pratique sportive. La culture, c’est autre chose que l’affrontement de bovins qui font 120 kilos dans la première ligne de rugby en se rentrant dans le lard avec une violence inouïe. C’est autre chose que le rassemblement de meute de spectateurs. C’est autre chose que la violence et l’infantilisation émotionnelle des supporters. Ce n’est pas cela la culture.
Le sport est aussi un instrument de massification totalitaire. Aujourd’hui il n’y a pas un État, qu’il soit dit « libéral », autoritaire ou totalitaire, qui n’utilise massivement le sport. Et ce grâce à une homologie structurelle entre le défilé militaire et défilé sportif. Le tout pour la pérennisation des régimes en place. Le sport est un instrument d’asservissement politique et cela est vrai mondialement : à l’Est comme à l’Ouest (avec le sport dit « socialiste » comme « capitaliste » au XXe siècle), au Nord comme au Sud. Le sport joue le même rôle de stabilisateur de l’ordre établi, quels que soient les régimes politiques des sociétés qui sont toutes sous l’hégémonie du capital financier international. Cela ne fait pas du sport une culture.
Si l’on prend le Sacre du Printemps ou la cinquième symphonie de Beethoven, elle peut être utilisée par les pouvoirs en place (les nazis l’ont fait par exemple) mais l’œuvre transcende, dépasse largement ces régimes. Alors que la « culture de masse » dont fait partie le sport s’épuise dans le moule des régimes politiques, elle ne peut les dépasser. Elle en est le produit. C’est une des raisons pour laquelle c’est une culture abrutissante, une culture Prisunic. Ce qui est terrible, c’est qu’une grande partie de la jeunesse – et notamment gauchisante – passe une partie de son temps à la consommer, par l’intermédiaire des écrans entre autre.
Quels pourraient être selon vous les progrès dans l’ « aliénation sportive » observables depuis dix ans ?
Aujourd’hui la critique du sport est ultra-minoritaire. Presque plus personne ne critique l’idéologie et la pratique sportive : nous passons pour des hurluberlus ! En 1980 aux Jeux olympiques de Moscou, ou en 2008 aux Jeux de Pékin, il y avait encore des comités de boycott. Aujourd’hui, ce type d’action et de critique me semble plus marginale. C’est ce qui me fait notamment dire que – par exemple – le passage de la flamme olympique dans les différentes bourgades françaises ne sera pas contesté.
Pour la quasi totalité des observateurs des pratiques sportives le sport serait en effet ni aliénation, ni émancipation, ni de gauche, ni de droite, ni répressif, ni permissif, ni réactionnaire, ni progressiste, mais tout cela à la fois dans un melting pot idéologique « à la carte ». Actuellement, nous pourrions évoquer les réflexions de Pascal Boniface, de Stéphane Beaud ou George Vigarello.
De la même manière, tous les syndicats sans exception [NDLR : la Confédération nationale du travail (CNT) et l’Union syndicale Solidaires s’opposent à la tenue des JO] ont accompagné l’accueil des JO de Paris et diront que cet événement est magnifique. Le problème dans tout cela c’est que l’idéologie sportive demeure largement impensée. Les gens peuvent admettre que le fascisme ou le libéralisme sont des idéologies politiques contestables. Mais le sport, lui, paraît propre, pur et universel. Et Pierre de Coubertin, je le rappelle, est la mère pondeuse de cette idéologie.
Votre analyse repose sur une vision du corps modelée par le freudo-marxisme, courant intellectuelle qui se structure dans les années 1950. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous définissez le corps et un quoi la pratique sportive l’aliène selon vous ?
Ma vision s’appuie sur celle de penseurs très importants comme Sigmund Freud, Herbert Marcuse ou Wilhem Reich. La question du corps est une question, au fond, philosophique. Il n’y a pas de corps en dehors d’une subjectivité. Et la subjectivité du sportif en tant que sportif n’existe pas, il ne fait que travailler sa capacité d’obéissance et de « résilience ». Sa subjectivité est atrophiée parce que le sportif est sous les ordres d’un entraîneur et contraint à un effort morcelé et rationalisé qui ne lui appartient pas.
Le corps se construit aussi dans l’intersubjectivité : dans le rapport aux autres. Et donc dans l’interculturalité, dans le rapport aux cultures dont sont porteur les autres. Le corps est une histoire, une singularité. La pratique sportive alliée à la publicité qui en est faite tend à homogénéiser les corps. La préoccupation devient la forme des muscles, le tracé des abdominaux, etc. Dans ce cadre, la subjectivité s’homogénéise, la dimension culturelle du corps est niée. Les corps perdent petit à petit leur histoire propre.
Dans la perspective du corps sportif, la question n’est plus : « Comment puis-je explorer mon corps, et m’épanouir à son contact ? », elle devient : « Comment peut-on augmenter mon corps ? ». Question qui a à voir avec les recherches menées dans le cadre du transhumanisme et du post-humain dont je viens de parler3. Ces dernières tendent aussi à nier le caractère biologique du corps, en plus de son caractère culturel. Le transhumanisme pense le corps comme une construction sociale modifiable à volonté pour se mettre au service des fins recherchées. Alors que le corps a un aspect biologique irrécusable. Il est en réalité un entremêlement de dimensions biologique, médical, psychologique, culturelle, spirituelle et philosophique. Et il faut bien dire que la pratique sportive encadre les pratiques corporelles et les aliènent à son principe de rendement.
À quoi pourrait ressembler une pratique physique qui soit émancipatrice ?
Je crois qu’il n’y en a pas pour l’instant. Pourquoi ? Parce que le fondement de la subjectivité corporelle, c’est d’une part la famille et d’autre part le travail. Tant que ce socle constitutif du corps n’aura pas été transformé en son fond, il n’y aura pas de libération de notre rapport à notre corps parce qu’il continuera d’être soumis à un principe de rendement, comme Herbert Marcuse en a d’ailleurs ébauché une critique remarquable.
En revanche, il est possible de trouver ici ou là des pratiques de transition qui ne soit pas totalement inféodées à la société capitaliste. À vrai dire, cela n’a rien de rédhibitoire de faire une partie de ping-pong entre copains, un peu de natation ou du canoë-kayak.
Mais si vous prenez une bande de potes qui jouent au foot le dimanche, très vite il va falloir trouver un arbitre parce que les deux équipes vont se chamailler pour gagner. Le principe compétitif est tellement implanté dans nos cervelles qu’il réapparaît automatiquement. Si on joue au ping-pong, c’est jamais marrant de se faire balader à gauche, à droite. On va alors rapidement se rebiffer et chercher à écraser l’autre.
Il faut bien comprendre que l’humain est porteur d’un principe de concurrence. Il faut l’accepter pour chercher à le détourner. C’est ce que le sport fait pour placer les uns vis-à-vis des autres en contradiction, en opposition. Il faut détourner cette concurrence – comme l’avaient fait les Grecs avec l’agôn – et tenter de la mettre au service de pratiques physiques imaginatives et profondément sociales.
Vous parlez dans l’un de vos ouvrages de la nécessité d’une transition d’un « corps fonctionnel » à un « corps ludique », que les aspects sensoriels du corps doivent primer sur les aspects moteurs, pouvez-vous revenir sur ces points ? Que pourrait donner ces pratiques physiques imaginatives ?
J’ai été pendant 25 ans professeur d’éducation physique et sportive. J’avais à m’affronter à des lycéens, globalement porteurs de l’idéologie de la compétition. J’essayais de leur faire comprendre, par le jeu, que l’on pouvait manipuler des ballons autrement que dans les règles instituées de la compétition, que c’est bien plus marrant et d’une certaine manière plus difficile.
Par exemple, je leur proposais de jouer au volley-ball avec un ballon de rugby, ce qui est loin d’être évident. Ou bien, je les faisais jouer au football (garçons et filles mélangées, ce qui n’était pas facile à l’époque) sur un terrain de basket. L’objectif était alors de toucher le poteau de basket avec la balle. Cela les stimulaient. Ensuite, je leur expliquais pourquoi nous explorions ces pratiques et cherchions à remettre en question le cadre. Vous imaginez que tout cela n’était pas très bien vu par mes collègues et surtout par l’inspection.
Ce qu’il faut bien avoir à l’esprit, c’est que le sport et le sportif sont aujourd’hui programmés. Il y a les catégories d’âge : minime, cadet, junior, senior, etc. avec un volume d’entraînement correspondant. Tel entraînement et régime alimentaire le matin, tel autre le soir. Cela n’est plus une vie. Nous retrouvons des logiques similaires avec les pratiques de coaching sportif où les gens forcent l’effort comme des malades mentaux, et se marrent bien peu . Il faut s’opposer dans notre vie quotidienne à cette programmation.
Mais tout cela est très difficile à critiquer. Il faut comprendre que le sport est un fait social total qui demande un certain nombre de références théorique pour être bien compris. Cela n’est pas évident, mais c’est cette compréhension que nous devons viser.
Propos recueillis par Gary Libot, journaliste au Chiffon.
Octobre 2023.
Par souci de clarté et à l’invitation de Jean-Marie Brohm, nous avons parfois réécrit et précisé des éléments de réflexion en s’inspirant de formules qu’il emploie dans son ouvrage « Théorie critique du sport », Quel sport ?, 2017.
- Lire à ce sujet la nouvelle édition de son ouvrage Pierre de Coubertin, le Seigneur des anneaux (Quel Sport ?)
- Groupe formé au début du XXe siècle de militants syndicaux qui réfléchissent à la transformation de l’institution scolaire et à des pédagogies alternatives.
- Lire l’article « Sport et science : data, prêts … Partez ! », consultable ici

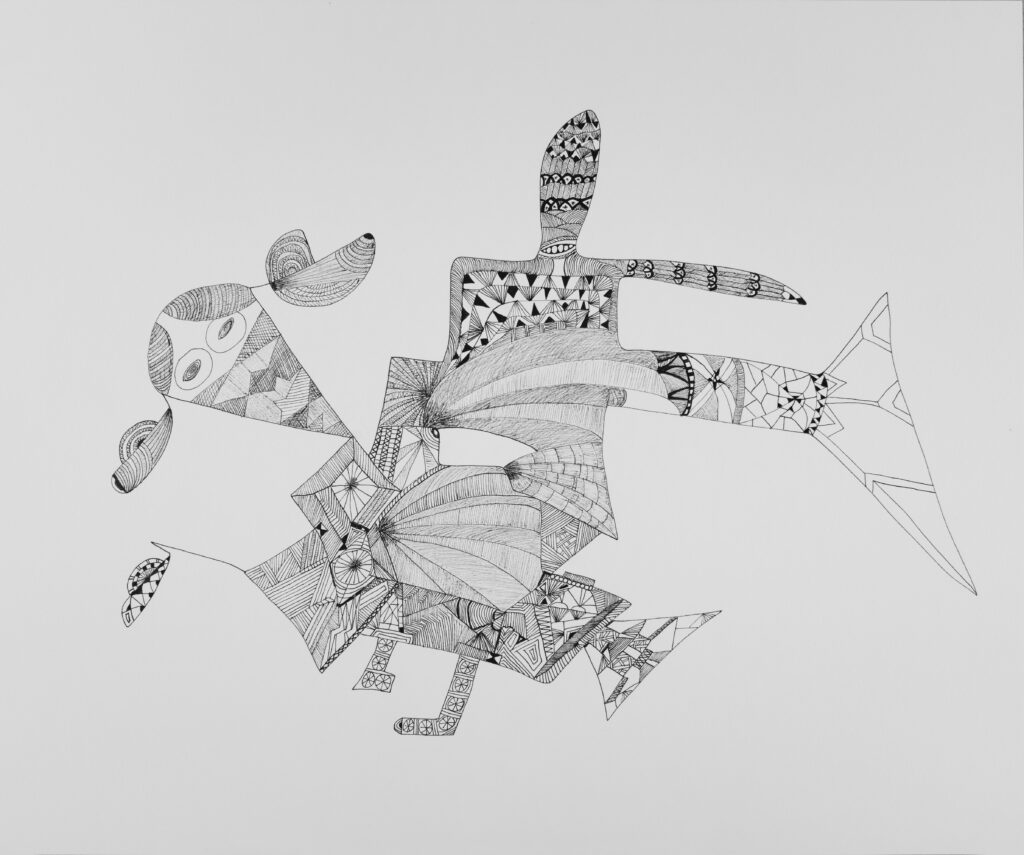

Ping : Et si le sport prônait la coopération et la lenteur ? – Monde25